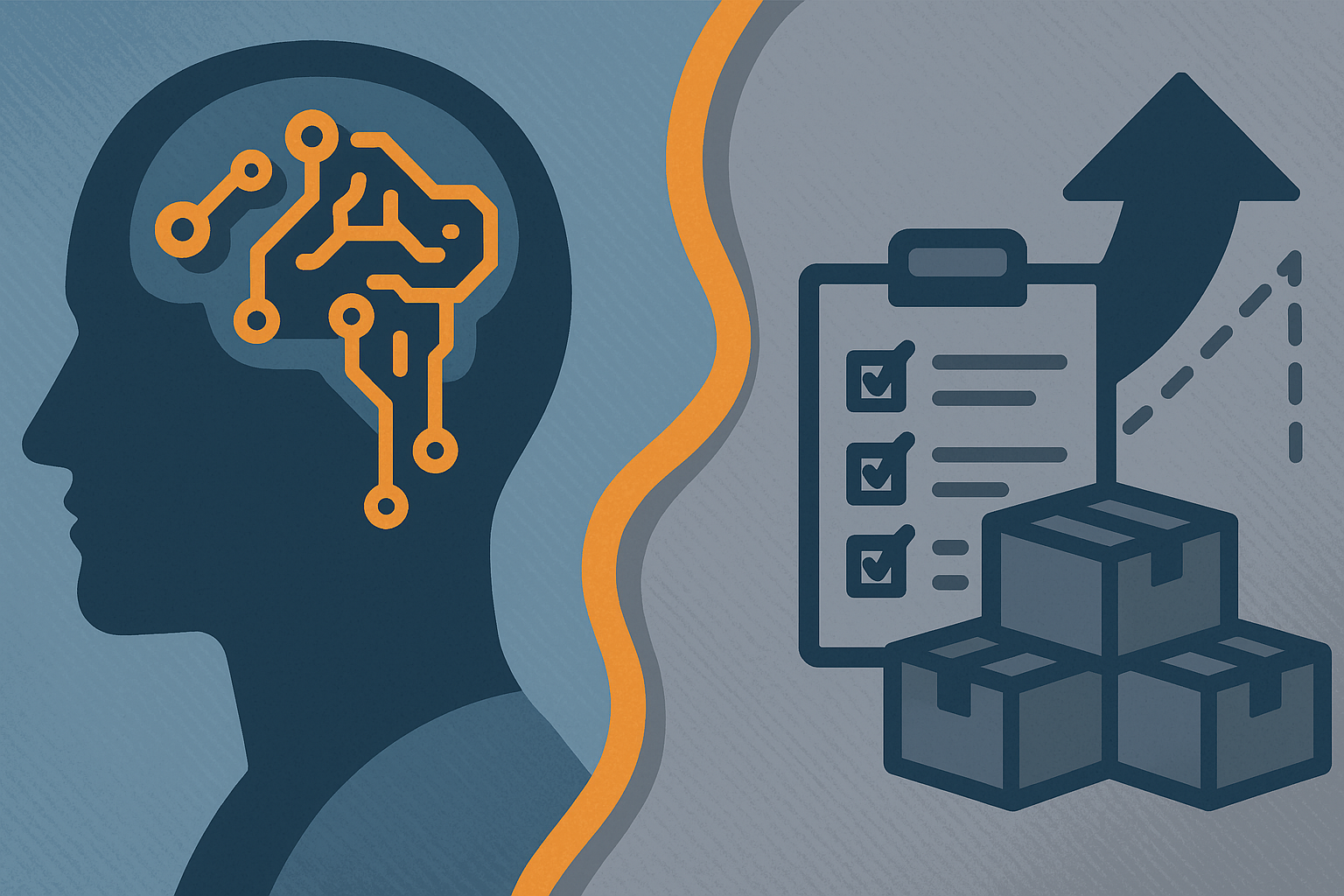Supply Chain en tant que paris économiques dans un monde orienté marché
Au cours des deux dernières décennies, j’ai vu la « gestion de la supply chain » accumuler des mots à la mode plus rapidement que des résultats. On parle de digital twins, de control towers, d’integrated business planning, de demand sensing, de resilience, de sustainability. Pourtant, si l’on examine attentivement les bilans et comptes de résultat, de nombreuses entreprises n’ont pas beaucoup progressé dans la façon de transformer le fonds de roulement, la capacité et la complexité en retours économiques.
Parmi les voix tentant de donner du sens à cette stagnation, certains ont plaidé en faveur de réseaux de valeur axés sur le marché et orientés de l’extérieur vers l’intérieur, et ont consacré d’importants efforts à mesurer la performance sur de longues périodes. Mon propre travail examine la même réalité économique sous un angle différent. Le but de cet essai est de clarifier cette perspective.

Dans mon livre Introduction to Supply Chain, notamment dans ses premiers chapitres, j’ai essayé de reconsidérer la gestion de la supply chain comme une discipline économique rigoureuse, axée sur la manière dont les entreprises répartissent des ressources rares dans un contexte d’incertitude. Le livre entre dans plus de détails que je ne peux l’aborder ici, mais l’idée centrale est simple : chaque fois que nous décidons quoi acheter, fabriquer, déplacer ou tarifer, nous plaçons de petits paris économiques aux issues incertaines. Une supply chain moderne devrait être jugée par la qualité de ces paris, ainsi que par les conséquences financières à long terme qu’ils génèrent.
Une ligne de recherche influente part d’un autre point. Elle examine de longues séries temporelles de mesures financières dans différents groupes de pairs et se demande : quelles entreprises ont réellement amélioré leur position en termes de croissance, de marge, de rotations de stocks et d’utilisation des actifs ? Certains désignent cela comme une « frontière efficace ». Je trouve ce point de vue utile. Là où nous diffèrons, ce n’est pas tant dans l’objectif que dans le mécanisme que nous pensons pouvoir nous y mener.
Deux points de vue sur le même problème
Une description courante présente les supply chains comme des réseaux de valeur axés sur le marché. L’accent est mis sur la détection des marchés, de l’extérieur vers l’intérieur. Plutôt que de considérer les commandes provenant du maillon suivant de la chaîne comme de la « demande », l’argument est que nous devons lire le marché réel : données de point de vente, stocks par canal, promotions, signaux sociaux, contraintes fournisseurs, chocs macroéconomiques. La supply chain est alors un ensemble de processus connectés qui transforment ces signaux en réponses coordonnées : planification, approvisionnement, fabrication, livraison.
Mon propre point de vue est plus étroit en apparence, mais affûté par conception. Je me concentre sur le moment de décision. Devons-nous acheter une unité supplémentaire de cet article pour cet entrepôt, à recevoir à cette date ? Devons-nous accélérer la production de ce lot, la retarder ou l’annuler ? Devons-nous baisser le prix de ce SKU pour ce canal demain, ou le maintenir tel quel ? Chacune de ces décisions consomme quelque chose de rare : liquidités, capacité, espace en rayon, attention humaine, bonne volonté auprès des clients ou des fournisseurs. Elle crée également une exposition à une gamme de futurs possibles.
Sous cet angle, la supply chain est une machine permettant de transformer l’incertitude en décisions, et les décisions en résultats financiers. Je suis moins intéressé par l’élégance du schéma de processus que par la qualité de la prochaine décision et celle qui suivra, à grande échelle.
Le point de vue orienté de l’extérieur vers l’intérieur observe le paysage depuis 10 000 mètres : comment l’entreprise se situe par rapport à ses pairs sur une frontière de performance multidimensionnelle. Pour ma part, je reste plus proche du terrain et me demande si les millions de petits paris qui constituent les opérations quotidiennes ont un sens économique, compte tenu de l’incertitude à laquelle nous faisons face. Ces points de vue ne sont pas contradictoires. Ils se contentent de zoomer sur différents niveaux d’un même système.
Qu’essayons-nous exactement d’optimiser ?
Si l’on élimine le jargon, ces différentes perspectives parlent toutes de performance. Mais elles choisissent des angles différents pour la définir.
Un angle est explicitement comparatif et pluriannuel. Il se préoccupe de la performance d’une entreprise par rapport à ses concurrents directs en termes de croissance du chiffre d’affaires, de marge opérationnelle, de rotations de stocks et parfois de cycles de trésorerie ou d’utilisation des actifs. Une entreprise qui croît rapidement mais qui voit sa marge s’éroder n’est pas excellente. Une entreprise qui réduit ses stocks tout en diminuant sa part de marché n’est pas excellente. L’excellence se situe sur une frontière efficace où ces indicateurs sont améliorés conjointement ou du moins bien équilibrés.
Mon propre angle est basé sur l’unité et le marginal. Je me concentre sur le rendement ajusté du risque de la décision marginale. Si j’achète une unité supplémentaire du produit X à placer en lieu Y pour la semaine Z, compte tenu de ce que je sais actuellement, quel est le gain financier attendu ? Combien de profit cette unité supplémentaire apporte-t-elle en moyenne, une fois que nous prenons en compte la probabilité qu’elle se vende à temps, la probabilité qu’elle se vende en retard à prix réduit, et la probabilité qu’elle ne se vende pas du tout et devienne obsolète ? Comment cela se compare-t-il à l’affectation de cette même unité de fonds de roulement à un autre produit, une autre localisation, ou simplement à ne pas l’investir ?
Pour raisonner à ce sujet, nous avons besoin d’une échelle commune. L’argent n’est pas tout, mais c’est l’unité dans laquelle l’entreprise règle ses obligations et mesure sa pérennité. J’insiste donc pour traduire tous les compromis qui encombrent les discussions sur la supply chain en termes financiers cohérents. Une rupture de stock n’est pas « mauvaise » en soi ; elle engendre des coûts en termes de marge perdue, d’affaires futures perdues et de détérioration de la réputation. Un excès de stocks n’est pas simplement du « gaspillage » ; c’est une option qui pourrait encore être rentable, ou se détériorer. Une capacité qui apparaît inoccupée sur un tableau de bord pourrait s’avérer précieuse comme tampon contre une volatilité qui n’est pas encore reflétée dans les données historiques.
La frontière efficace et le rendement marginal ajusté au risque sont deux manières d’aborder le même phénomène sous-jacent. Un point de vue considère l’intégrale : la trajectoire pluriannuelle à long terme de l’entreprise. Pour ma part, je m’intéresse à la dérivée : l’effet incrémental de la prochaine décision. En pratique, on ne peut pas avoir une intégrale satisfaisante avec une dérivée défectueuse pendant longtemps. L’excellence persistante sur la frontière exige en fin de compte que les décisions quotidiennes, sur des milliers d’articles et de sites, soient économiquement raisonnables compte tenu de l’incertitude.
Prévisions, plans et l’illusion de la certitude
Certains des critiques les plus persistants de la pensée « inside-out » ont souligné que les entreprises traitent leurs propres commandes et expéditions historiques comme s’ils représentaient fidèlement la demande. Cette vision est à la fois tardive et biaisée. Les commandes sont façonnées par les promotions, les règles d’allocation, les ruptures de stock en amont, la mauvaise intégration des données et une multitude d’autres distorsions. Dans cette vision alternative, une supply chain moderne devrait être « outside-in » : partir des signaux réels du marché et d’approvisionnement, puis orchestrer la réponse.
Je suis d’accord avec la critique de la planification « inside-out », mais j’aborde la question sous un angle probabiliste. Les prévisions, telles qu’on les pratique communément, imposent une illusion de certitude confortable. Nous prenons un avenir désordonné et incertain et le compressons en un seul chiffre : la « demande attendue » pour une période donnée. Nous construisons ensuite des stocks de sécurité et des plans déterministes autour de ce chiffre, comme si l’erreur n’était qu’une nuisance marginale plutôt que l’élément central.
Cette méthode de travail élimine précisément l’information dont nous avons le plus besoin : l’éventail des futurs plausibles et leurs probabilités. Dans mon propre travail, je soutiens que les prévisions devraient être des distributions, et non des points précis. La question n’est pas « Quelle est la prévision de ventes pour le mois prochain ? » mais « À quoi ressemble la distribution de probabilité des ventes possibles ? » Quelles sont les chances de ne rien vendre ? De vendre deux fois le volume habituel ? À quoi ressemblent les extrémités ?
Une fois que nous disposons de telles distributions, le plan cesse d’être un unique « chiffre consensuel » négocié en réunions et devient une série de décisions calculées par des algorithmes qui évaluent les coûts et les opportunités sous ces distributions. La même distribution de la demande peut justifier des décisions concernant les stocks ou la production très différentes en fonction des conséquences financières des ruptures de stock versus un excès, des délais impliqués, et de la disponibilité des substituts.
Ici encore, ces critiques réagissent à la même défaillance : faire semblant que le comportement incertain et non linéaire puisse être représenté dans une seule colonne d’un tableur. Une approche prône des signaux plus riches et plus précoces ainsi que des refontes de processus qui déplacent la planification vers une approche outside-in. Pour ma part, je préconise des modèles probabilistes qui nous obligent à affronter l’incertitude de manière explicite et des systèmes de décision capables de traiter ces modèles à grande échelle.
Dans une pratique saine, ces deux préoccupations devraient converger. Vous voulez de bons signaux et une représentation réaliste de l’incertitude ; des flux outside-in alimentant des décisions probabilistes et économiquement fondées.
Technologie : architecture versus moteur
De nombreux observateurs soulignent les limites de la pile technologique que la plupart des entreprises ont héritée. Ces piles ont été construites principalement pour l’efficacité transactionnelle : enregistrement des commandes, des expéditions, des factures, etc. Elles intègrent les données entre les fonctions, mais n’aident pas nécessairement les entreprises à prendre de meilleures décisions. Le remède habituel qui est proposé est de repenser l’architecture autour des flux d’information de la demande et de l’offre : des couches de données externes, de meilleures taxonomies, une visibilité des stocks en quasi temps réel, et des outils analytiques plus flexibles.
Je conviens que la pile héritée constitue une grande partie du problème. Cependant, je préfère mettre l’accent ailleurs. La capacité essentielle qui manque, à mon avis, n’est pas une autre couche d’intégration ou un autre tableau de bord, mais un moteur de décision.
Par là, j’entends un logiciel qui, chaque jour, prend en compte toutes les données pertinentes, toutes les contraintes actuelles, et un ensemble d’évaluations économiques, puis propose ou émet directement des décisions concrètes : quelles commandes d’achat passer, quels ordres de production planifier, quels transferts exécuter, quels prix ajuster. Ce moteur doit être programmable, vérifiable, et suffisamment rapide pour traiter des millions de telles décisions en un temps raisonnable. Il doit également être capable d’expliquer, a posteriori, pourquoi une décision particulière a été prise, compte tenu des données et des évaluations à ce moment-là.
Les architectures orientées outside-in sont utiles car elles fournissent de meilleures entrées à un tel moteur. Mais sans le moteur, elles risquent de se transformer en systèmes de reporting plus sophistiqués. Vous verrez le problème plus clairement, avec plus de nuances et davantage de mesures de latence, mais vous continuerez à dépendre d’armées de planificateurs manipulant des chiffres dans des tableurs, essayant de réconcilier manuellement des objectifs conflictuels.
Il n’est pas controversé de soutenir que la technologie devrait servir à une meilleure modélisation et à de meilleures décisions, et pas seulement à une meilleure intégration. Mettre l’accent sur l’architecture permet de souligner où les données doivent circuler et comment les processus doivent être organisés. Mon insistance sur le moteur met en lumière ce qui doit ultimement se faire avec ces données : un grand nombre de décisions économiquement sensées dans un contexte d’incertitude. Ce sont des préoccupations complémentaires, mais je placerais personnellement le moteur au centre, avec l’architecture à son service.
Organisation, gouvernance et le rôle du S&OP
De nombreux écrits contemporains tournent autour de la planification des ventes et des opérations et de son évolution. Il existe des modèles de maturité dans lesquels le S&OP progresse, passant de simples vérifications de faisabilité à une planification axée sur le profit, puis à une orchestration axée sur la demande et enfin orientée marché. Dans ces récits, le S&OP est le principal processus horizontal qui traverse les silos et aligne les fonctions. C’est là que les compromis sont négociés et que la perspective outside-in est introduite.
Je partage le diagnostic selon lequel les silos sont une source majeure de destruction de valeur. Lorsque chaque fonction optimise ses propres indicateurs — taux de service ici, utilisation là, précision des prévisions ailleurs — l’ensemble du système en pâtit. Les gens déploient d’énormes efforts pour résoudre les conflits entre des plans qui n’ont jamais été conçus pour être compatibles.
Là où je diverge, c’est sur la centralité que le S&OP, en tant que réunion de planification, devrait conserver à long terme. À mon avis, si nous faisons correctement notre travail du côté technologique, l’essentiel de la planification opérationnelle devrait être délégué au moteur de décision que j’ai décrit précédemment. Ce moteur est alimenté par les données les plus récentes et par les évaluations économiques actuelles (par exemple, le coût relatif d’une rupture de stock versus un excès pour un article donné, ou la valeur d’une journée de réduction du délai de livraison pour un itinéraire donné). Il recalcule les décisions optimales au fur et à mesure que les conditions changent, bien plus souvent et de manière plus cohérente que ne le peut un processus manuel.
Ce qui reste pour le S&OP ou la planification intégrée des affaires, c’est la gouvernance plutôt que la planification. Au lieu de passer leur temps à ajuster les quantités dans un tableur, les dirigeants devraient consacrer leur temps à ajuster les règles du jeu : les évaluations financières, les contraintes, l’appétit pour le risque. Ils devraient examiner comment les décisions du moteur se traduisent en résultats réalisés et utiliser ce retour d’information pour affiner les paramètres économiques et les hypothèses structurelles.
Il s’agit d’un changement subtil mais profond. Il transforme le S&OP, passant d’une tentative collective de concevoir manuellement un « plan unique et correct » à une révision périodique de la performance d’un système de décision automatisé, compte tenu des objectifs de l’entreprise. L’attention humaine passe de la microgestion des quantités à la calibration des incitations et des contraintes.
Les modèles de maturité de ce type peuvent encore être utiles dans ce contexte, notamment en tant qu’outil de diagnostic pour évaluer la position d’une entreprise sur le plan culturel et organisationnel. Mais je soutiendrais que l’état final consiste moins en des réunions de planification plus sophistiquées qu’en une meilleure gouvernance économique des systèmes de décision automatisés.
Comment savons-nous ce que nous savons ?
La supply chain est un domaine délicat d’un point de vue épistémologique. Les expériences sont coûteuses, les environnements sont bruyants, et le nombre de variables est intimidant. Il est facile de confondre des récits plausibles avec des connaissances solides.
Certains chercheurs, par exemple Lora Cecere, ont investi des efforts considérables pour fonder leurs perspectives sur des données financières. Plutôt que de se fier à des enquêtes autodéclarées ou à des anecdotes de conseil, ils ont reconstruit l’historique de la performance des entreprises à partir de rapports financiers publics et recherché des tendances au fil du temps. Cela ne prouve pas la causalité, mais cela impose une discipline : les pratiques que nous célébrons comme « les meilleures » devraient au moins être corrélées avec des améliorations à long terme de la croissance, des marges et des rotations de stocks.
Mon propre scepticisme prend une forme différente. Je m’inquiète de la survie de techniques dont la principale vertu était autrefois la commodité computationnelle — des formules de stock de sécurité basées sur des hypothèses héroïques, des modèles linéarisés de phénomènes manifestement non linéaires, des hiérarchies de planification simplifiées qui reflètent les organigrammes plus que la réalité économique. Nombre de ces artefacts ont persisté parce qu’ils étaient faciles à calculer sur papier ou avec les premiers ordinateurs. Aujourd’hui, nous disposons de bien plus de puissance de calcul, et pourtant nous nous y accrochons.
Je m’inquiète également des structures d’incitation. Les fournisseurs de logiciels, les consultants, les universitaires et les parties prenantes internes ont tous des raisons de préférer des récits qui justifient de grands projets, des cadres complexes ou des ajustements incrémentaux. Il y a relativement peu d’incitation à prouver qu’une méthode appréciée perd systématiquement de l’argent en pratique.
La réponse, à mon avis, consiste à rapprocher la supply chain de l’économie appliquée avec une forte composante empirique et computationnelle. Nous devrions formuler nos hypothèses de manière explicite, les encoder dans des algorithmes, et les confronter à la réalité à travers les résultats financiers de l’entreprise. Lorsqu’une politique détruit systématiquement de la valeur dans un contexte particulier, nous devrions l’abandonner, quelle que soit son élégance ou sa large diffusion.
À ce sujet, ces perspectives convergent. Il y a un rejet commun de l’idée qu’existent des “best practices” intemporelles qui n’attendent qu’à être mises en œuvre. Il n’existe que des pratiques qui fonctionnent dans un contexte donné, pendant un certain temps, jusqu’à ce que l’environnement ou le paysage concurrentiel change.
Vers une synthèse
Si vous êtes un cadre ou un praticien essayant de naviguer dans ces idées, il peut être utile de penser en termes de niveaux.
Le travail orienté de l’extérieur vers l’intérieur, ancré financièrement, est inestimable au niveau stratégique et diagnostique. Il vous aide à poser les bonnes questions : Où nous situons-nous sur la frontière efficace par rapport à nos pairs ? Croissons-nous, sommes-nous rentables et économes en capital, ou échangeons-nous une dimension contre une autre ? Nos processus restent-ils orientés de l’intérieur vers l’extérieur, dominés par l’inertie des transactions ERP et des silos fonctionnels, ou sommes-nous véritablement passés à des flux pilotés par le marché, orientés de l’extérieur vers l’intérieur ?
Mon propre travail est davantage axé sur le niveau opérationnel et computationnel. Je veux que vous puissiez répondre à des questions telles que : Compte tenu de notre compréhension actuelle de l’incertitude de la demande et de l’offre, et de nos évaluations financières, les décisions que nous prenons chaque jour maximisent-elles réellement notre rendement ajusté au risque sur des ressources rares ? Pouvons-nous prendre ces décisions de manière cohérente et à l’échelle par le biais de logiciels, plutôt que manuellement, tout en conservant la capacité d’auditer et d’améliorer la logique sous-jacente ?
Ces niveaux ne sont pas des alternatives. Dans un monde idéal, une entreprise utiliserait la perspective stratégique pour définir ce à quoi ressemble l’excellence et mesurerait les progrès sur plusieurs années, tout en utilisant un moteur de décision économique et probabiliste pour orienter les opérations quotidiennes vers cet objectif. L’architecture orientée de l’extérieur vers l’intérieur alimenterait le moteur avec des signaux riches et opportuns. Les forums de gouvernance se concentreraient sur la calibration des paramètres économiques plutôt que sur la modification des quantités. Et la notion de “best practice” serait remplacée par une approche plus humble et empirique : ce qui fonctionne, ici et maintenant, dans ce réseau spécifique, tel que révélé par les résultats financiers réels.
En ce sens, toute confrontation apparente entre ces points de vue n’est pas un affrontement entre des théories incompatibles. Il s’agit d’une conversation sur l’endroit où placer l’accent : sur l’architecture et les processus, ou sur les algorithmes et l’économie ; sur les trajectoires à long terme, ou sur les décisions marginales. Les deux perspectives sont nécessaires. Mais si je devais résumer ma propre position en une seule phrase, ce serait la suivante :
Supply chain est, au cœur, une discipline économique qui devrait être pratiquée par le biais de logiciels en tant qu’art de faire de bons paris face à l’incertitude.
Tout le reste — processus, architectures, tableaux de bord, voire modèles de maturité — devrait être jugé en fonction de la mesure dans laquelle ils facilitent ou entravent cette tâche centrale.