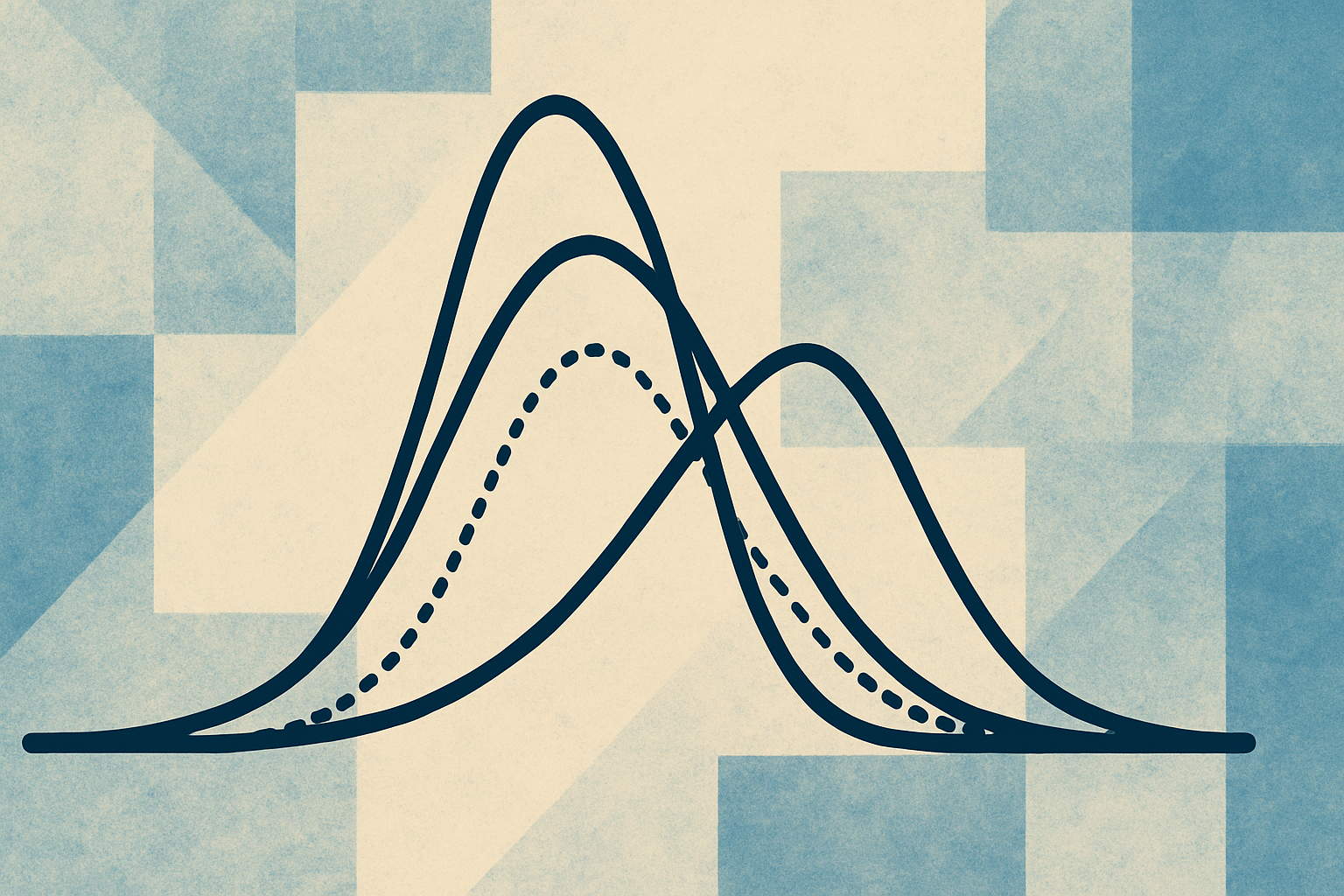Une réflexion sur l'œuvre de David Simchi-Levi
Parmi les professionnels de la supply chain, on me demande souvent comment mes points de vue se rapportent à ceux de David Simchi-Levi, dont les manuels et les recherches ont façonné une grande partie du vocabulaire moderne du domaine. C’est une question naturelle : de nombreux praticiens ont appris la supply chain grâce à ses modèles et études de cas bien avant de découvrir mes propres travaux. Nos conclusions riment souvent, mais les chemins que nous empruntons pour y parvenir diffèrent de manière significative, et ces différences — dans la manière dont nous encadrons la discipline, l’avenir et le rôle du logiciel — ont des conséquences pratiques sur la façon dont les entreprises conçoivent et exploitent leurs supply chains.

J’ai exposé mes points de vue plus en détail ailleurs, notamment dans mon livre Introduction to Supply Chain et dans l’essai Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World, mais mon objectif ici est modeste : clarifier ma propre perspective en la plaçant côte à côte avec celle de Simchi-Levi. Je me concentrerai sur son manuel très lu Designing and Managing the Supply Chain et sur son ouvrage de management Operations Rules, ainsi que sur ses travaux concernant le risque de supply chain et la digitalisation.
Que gérons-nous réellement ?
Si vous consultez un manuel typique d’opérations pour connaître la gestion de la supply chain, vous êtes susceptible de lire une variante du texte suivant : l’intégration des fournisseurs, usines, entrepôts et magasins de manière à ce que le produit approprié soit livré au bon endroit, au bon moment, et ce, au coût total minimal, sous réserve des exigences de taux de service. Le manuel de Simchi‑Levi reste fidèle à cet esprit et réussit à développer de bons modèles autour de celui-ci.
Cette définition n’est pas fausse ; elle est simplement incomplète. Elle décrit l’infrastructure, mais pas le véritable jeu.
Pour moi, la supply chain est avant tout une activité économique. Les entreprises n’ont pas pour vocation de “minimiser les coûts logistiques” ou de “maximiser les taux de service” de manière abstraite. Elles se consacrent à l’allocation de ressources rares aux usages alternatifs – liquidités, capacité, espace d’étagère, voire l’attention des planificateurs – dans l’espoir d’obtenir davantage d’argent, plus rapidement. En ce sens, la supply chain est une application de l’économie dans l’incertitude, matérialisée par le logiciel. J’expose cette vision de manière plus systématique – en décrivant la supply chain comme un portefeuille de paris économiques dans un contexte d’incertitude – dans Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World.
Une fois que vous envisagez la supply chain de cette manière, l’objet central n’est pas le camion ou l’entrepôt, mais l’option : la capacité de réaliser une action de valeur lorsque les circonstances évoluent d’une certaine manière plutôt qu’une autre. Le stock est une option de vente. Une capacité de production excédentaire est une option pour réagir à un pic. Un second fournisseur est une option pour éviter d’être pris en otage. L’objectif de la discipline est de cultiver et d’exercer ces options de manière à générer des rendements supérieurs.
Simchi‑Levi reconnaît certainement l’incertitude, et il a écrit de manière approfondie sur la mutualisation des risques, l’atténuation des effets coup de fouet, et la conception de réseaux flexibles. Là où nos points de vue divergent, c’est que, pour lui, l’incertitude est quelque chose à contrôler ; pour moi, c’est la substance même à partir de laquelle la supply chain extrait de la valeur.
Fonctions objectives : l’argent contre des substituts
Un deuxième domaine où nos perspectives divergent concerne la question de ce que nous essayons d’optimiser.
Dans Designing and Managing the Supply Chain, la formulation standard consiste à minimiser le coût total du système – production, transport, stocks, installation – sous réserve des contraintes de taux de service et de capacité. C’est dans ce langage que de nombreux modèles d’optimisation en recherche opérationnelle ont été rédigés : une somme pondérée des coûts ici, une contrainte de taux de service là.
Dans Operations Rules, Simchi‑Levi franchit une étape importante. Il insiste sur le fait que la stratégie opérationnelle doit être ancrée dans la proposition de valeur de l’entreprise et soutient que la flexibilité est l’élément clé permettant de relier les opérations à la valeur client. C’est un message puissant, et je suis entièrement d’accord avec l’idée que la flexibilité a une valeur disproportionnée.
Ce que je trouve problématique, c’est de laisser la fonction objectif au niveau des “coûts et taux de service” ou de la “valeur client” sans tout faire passer par le filtre étroit de l’argent et du temps. Si nous ne réduisons pas nos nombreux indicateurs à quelque chose comme un taux de rendement sur le capital et le risque que nous déployons, nous optimisons en réalité des substituts. Ces substituts sont pratiques, mais ils constituent également des sources subtiles de désalignement. Il est tout à fait possible d’améliorer les taux de service et de réduire les coûts locaux tout en détruisant la valeur pour les actionnaires une fois que l’intensité capitalistique, le risque et le coût d’opportunité sont correctement pris en compte.
Ceci n’est pas une invitation à vénérer un KPI magique unique. C’est un appel à reconnaître qu’au bout du compte, les décisions de supply chain sont des décisions d’investissement. Elles devraient être encadrées et évaluées comme telles.
Planifier l’avenir versus s’y préparer
Un troisième différend concerne notre attitude envers l’avenir lui-même.
Les travaux de Simchi‑Levi partent du principe, à juste titre, que les entreprises vont planifier. Les prévisions sont affinées, les processus push et pull sont séparés, des cibles de stocks sont fixées, et les capacités sont allouées. De meilleurs modèles, la mutualisation des risques et des contrats rendent ces plans plus robustes. La vision du monde sous-jacente est qu’il existe un plan “optimal” pour le réseau, et que notre tâche est de nous en approcher malgré l’incertitude.
Mon expérience dans l’industrie m’a rendu méfiant à l’égard de cette mentalité de planification. Non pas parce que la planification soit inutile, mais parce que sa pratique tend à confondre prédiction et contrôle. Les prévisions sont traitées comme une sorte de vérité fragile sur l’avenir. Une fois validées, elles deviennent une contrainte à laquelle tout le monde doit se conformer. Les écarts sont perçus comme des échecs d’exécution plutôt que comme des signaux provenant de la réalité.
Pour moi, l’avenir n’est pas une spécification technique que nous pourrions atteindre si nous travaillions suffisamment dur sur nos tableurs de planification. C’est un environnement contesté, dépendant du chemin et profondément incertain, façonné par des concurrents, des régulateurs, des clients et des événements aléatoires. Dans ce contexte, la question clé n’est pas “Quel est le plan optimal ?” mais “Quel portefeuille d’options nous faut-il afin que, lorsque l’avenir nous surprend, nous en soyons plus souvent aidés que lésés ?”
Les travaux de Simchi‑Levi sur l’exposition au risque concernent en grande partie ce portefeuille, même s’il utilise un langage différent. Son Indice d’Exposition au Risque, fondé sur les notions de temps de récupération et de temps de survie, offre une méthode quantitative pour identifier quelles installations ou quels fournisseurs présentent le risque de perturbation le plus élevé et pour prioriser les mesures d’atténuation. J’applaudis cela. Ma critique ne porte pas sur l’outil, mais sur la croyance résiduelle que, une fois que nous avons ajusté notre réseau et effectué nos tests de résistance, nous sommes “de retour sur la bonne voie” pour atteindre un plan.
Pour ma part, je préconise un mode de prise de décision qui ne consiste pas tant à converger vers une seule prévision qu’à tarifer et retarifer continuellement les options à mesure que de nouvelles informations arrivent. En pratique, cela signifie adopter des visions probabilistes de la demande et de l’offre, et les intégrer directement dans la logique même des décisions plutôt que de les traiter comme une activité de prévision distincte alimentant les réunions de planification. J’exposais déjà cette critique des prévisions à un seul chiffre et de la planification par consensus dans la section “Prévisions, plans et l’illusion de certitude” de Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World.
Le rôle du logiciel : des enregistrements aux décisions
Ici, le contraste ne se situe pas tant entre Simchi‑Levi et moi, mais plutôt entre deux époques.
Simchi‑Levi écrit dans la tradition de la recherche opérationnelle. Ses livres présentent des modèles – pour la conception de réseaux, les stocks, les contrats, la flexibilité – et des études de cas montrant comment les entreprises peuvent utiliser ces modèles pour améliorer leurs performances. La technologie de l’information apparaît comme un facilitateur : un moyen de mettre en œuvre une meilleure planification, de collecter de meilleures données, et, plus récemment, d’appliquer l’analytics et le machine learning à grande échelle. Son travail plus récent combine explicitement la digitalisation, l’analytics et l’automatisation comme les trois piliers d’une supply chain moderne.
Je partage cet enthousiasme pour les données et l’analytics, mais j’accorde bien plus d’importance à l’architecture logicielle elle-même. Au cours des deux dernières décennies, la plupart des grandes entreprises se sont retrouvées avec une pile de “systems of records” – ERP, WMS, TMS et autres – pour enregistrer les transactions. Par-dessus cela, elles ont construit ou acheté des outils de reporting et de planification qui découpent et analysent l’historique et aident à coordonner les décisions humaines. Ce qui manque encore en grande partie, c’est une couche dédiée dont le seul but est de prendre et d’exécuter des décisions automatiquement, à grande échelle, en situation d’incertitude.
Ces systèmes de décision ne sont pas de simples “rapports astucieux”. Ils codent une véritable logique économique : quel compromis acceptable entre le risque de rupture de stock et le coût d’opportunité du capital ; quand il est rationnel de payer pour une seconde source ; comment réallouer une capacité rare lorsque la demande explose dans une région et s’effondre dans une autre. Ils fonctionnent quotidiennement, voire toutes les heures, avec une intervention humaine minimale. Leur performance n’est pas mesurée par les économies projetées dans un business case, mais par les flux de trésorerie réalisés.
Rien dans les écrits de Simchi‑Levi ne contredit cette vision. Au contraire, son insistance sur le fait que les entreprises devraient utiliser l’analytics et le machine learning pour améliorer la tarification, les promotions et les opérations est entièrement en phase avec celle-ci. Là où je vais plus loin, c’est en soutenant que, à moins que les entreprises ne traitent l’ingénierie de ces systèmes de décision comme un problème logiciel de première classe, elles ne pourront jamais pleinement bénéficier des modèles et des insights que des universitaires comme lui produisent depuis des décennies.
Incitations et le système humain autour des modèles
Les modèles et les logiciels ne vivent pas dans un vide. Ils s’insèrent au sein d’organisations peuplées de personnes animées par des incitations, des craintes et des plans de carrière. Ici encore, mon approche diffère quelque peu de celle de Simchi‑Levi.
Ses manuels reconnaissent les objectifs mal alignés entre les achats, la production, la logistique et les ventes, et il aborde des mécanismes contractuels ainsi que des schémas de coordination pour aligner les partenaires de supply chain. C’est un sujet important, et ses travaux sur les contrats, la flexibilité et le partage des risques sont largement cités.
Mon expérience avec de grandes implémentations m’a rendu plus pessimiste quant à la facilité avec laquelle ces désalignements peuvent être corrigés par la seule bonne volonté et de bons contrats astucieux. Certains conflits d’intérêts sont structurels. Un fournisseur de logiciels payé par utilisateur a peu d’incitation à automatiser le travail des planificateurs. Un consultant facturant à la journée est peu susceptible de recommander la solution la plus simple qui rendrait sa présence superflue. Une fonction dont le prestige dépend de l’effectif résistera instinctivement à l’automatisation.
Ce ne sont pas des défaillances morales ; ce sont simplement des comportements prévisibles dans certains systèmes d’incitation. Pour les leaders de la supply chain, cela implique que l’architecture du système de décision inclut celle du système humain qui l’entoure : qui détient le pouvoir décisionnel, qui est récompensé pour quoi, qui a l’autorité pour passer d’un mode manuel à un mode automatisé. Sans cela, même les meilleurs cadres analytiques se verront réduits à quelque chose de politiquement acceptable mais économiquement médiocre.
Convergences qui méritent d’être préservées
Jusqu’à présent, j’ai mis l’accent sur les différences, car elles éclairent ma propre position. Il est tout aussi important de reconnaître les points de convergence entre Simchi‑Levi et moi, car ces convergences nous en apprennent long sur la direction que prend le domaine, presque indépendamment du point de départ philosophique.
Nous traitons tous les deux les supply chains comme des systèmes et rejetons l’optimisation locale en silo. Nous considérons tous deux l’incertitude et la variabilité comme des éléments centraux, et non comme des nuisances périphériques. Nous pensons tous les deux que la flexibilité – que vous l’appeliez flexibilité ou optionalité – a une valeur disproportionnée, et que les entreprises devraient être prêtes à en payer le prix. Nous voyons également les données, l’analytics et l’automatisation comme essentiels à toute tentative sérieuse d’amélioration.
Ces convictions partagées ne sont pas anodines. Il y a vingt ans, le discours dominant dans de nombreuses salles de conseil portait encore sur le lean, le juste-à-temps et le single‑sourcing – l’efficacité comme une fin en soi. Aujourd’hui, après les confinements, les guerres et les crises financières, la conversation se tourne lentement vers la résilience, l’optionnalité et les capacités digitales. Les travaux de risque d’exposition de Simchi‑Levi ont contribué à introduire ce changement dans les salles de conseil et même dans les cercles de politiques publiques. Je considère mes propres travaux comme faisant partie de ce mouvement, bien qu’avec un accent et un vocabulaire différents.
Pourquoi les détails philosophiques comptent
On pourrait se demander : si les prescriptions riment souvent – plus de flexibilité, une meilleure analytics, une conception plus holistique – pourquoi se préoccuper des disputes philosophiques concernant les objectifs et la nature de l’avenir ?
Parce que, en pratique, ces détails philosophiques se répercutent sur les décisions de conception.
Si vous pensez en termes de “minimiser le coût pour un taux de service donné,” vous serez tenté de traiter les objectifs de service comme exogènes et de les rigidifier en contrainte. Si vous pensez en termes de “maximiser le rendement économique dans l’incertitude,” vous serez plus enclin à vous interroger sur la justification économique des objectifs de service eux-mêmes, et à les ajuster dynamiquement à mesure que les conditions évoluent.
Si vous considérez l’avenir comme quelque chose qui peut être approché par un plan unique, vous investirez massivement dans des cycles de planification, des réunions et la construction d’un consensus. Si vous voyez l’avenir comme une source de surprises à exploiter, vous investirez davantage dans des pipelines de données, des moteurs de décision automatisés, et des options qui vous offrent la marge de manœuvre nécessaire lorsque les plans se brisent inévitablement.
Si vous considérez l’informatique principalement comme une fonction de support pour mettre en œuvre une meilleure planification, vous achèterez un autre module pour votre ERP. Si vous la voyez comme le médium dans lequel réside votre logique économique, vous vous préoccuperez de la séparation entre les systems of records et les systems of decision, de la gestion des versions des modèles, de l’expérimentation et de la reprise en toute sécurité.
Le travail de Simchi‑Levi incite les entreprises dans les bonnes directions sur nombre de ces fronts. Ma propre contribution consiste à soutenir que nous devons aller plus loin : traiter la supply chain comme une discipline d’ingénierie décisionnelle économique dont le domicile naturel est le logiciel ; mesurer notre succès en définitive en argent et en temps ; et construire des organisations et des systèmes qui considèrent l’incertitude non pas comme un ennemi à supprimer, mais comme la matière première du profit.
Sur ces points, le contraste n’est pas personnel. C’est un choix que chaque leader de supply chain doit faire.