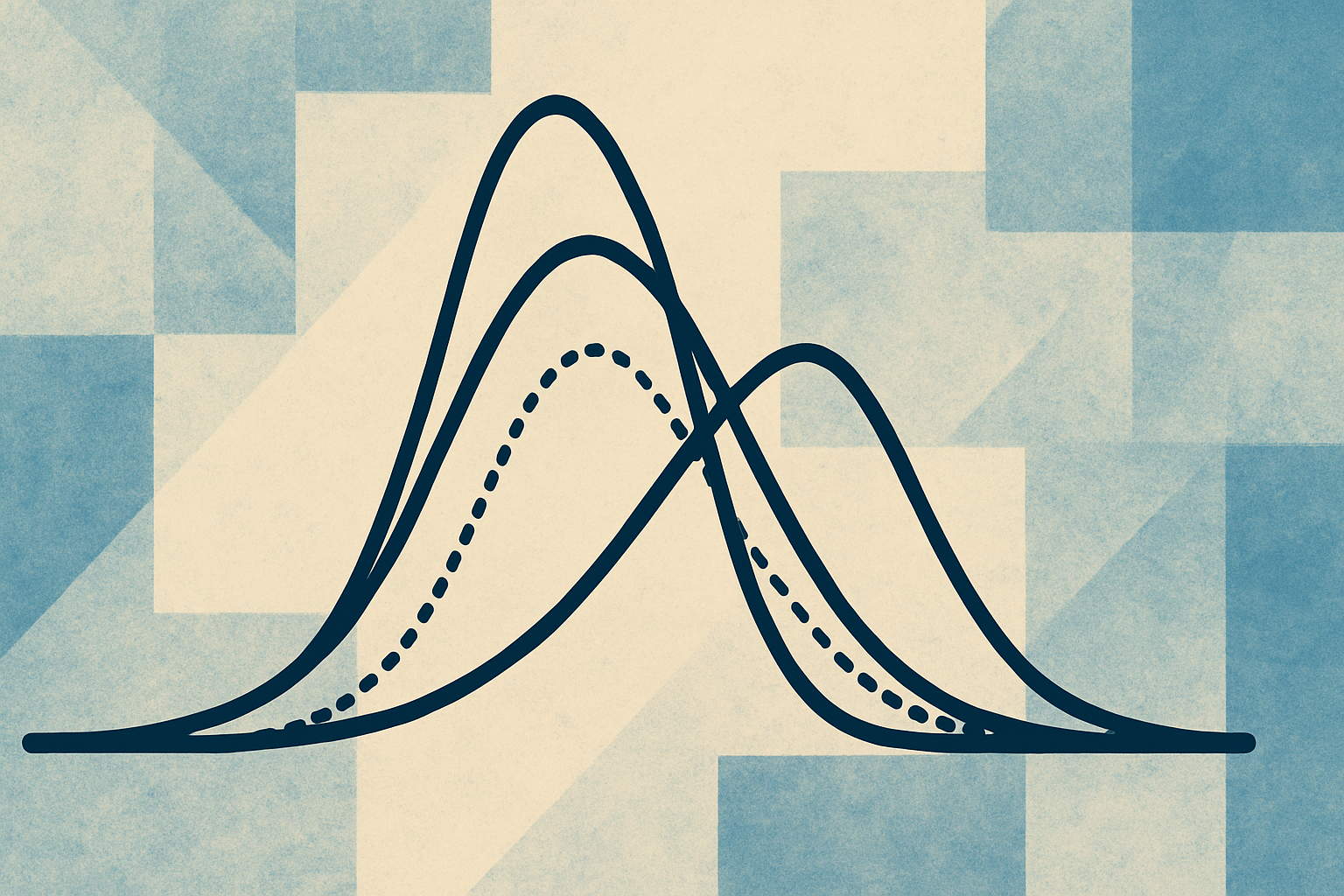La résilience de la Supply Chain reconsidérée
Au cours des dernières années, “résilience” est devenu l’un de ces mots que les dirigeants se sentent obligés d’utiliser à chaque deuxième phrase. Après chaque perturbation – un confinement, une guerre, un canal bloqué – la même question revient : “Comment rendre notre supply chain plus résiliente ?” Les conversations sont sincères; les réponses sont souvent vagues. “Plus de visibilité”, “plus de collaboration”, “plus d’agilité” – des mots qui sonnent positivement mais qui expliquent très peu ce que nous devrions réellement faire de différent, chaque jour, lorsque nous décidons de ce qu’il faut acheter, fabriquer, déplacer et tarifer.

Dans mon livre Introduction to Supply Chain, j’ai proposé une vision de la supply chain comme la gestion disciplinée des décisions en situation d’incertitude, avec l’économie – et non le taux de service ou l’utilisation – comme principale référence. Cette vision a façonné ma manière de concevoir la résilience. En fait, elle m’a conduit à une définition bien plus restreinte que ce que l’on trouve généralement dans les manuels, les brochures de conseil ou les programmes de certification.
Ce que j’entends par “résilience”
Quand je parle de la résilience de la supply chain, j’ai en tête quelque chose de très précis.
Une entreprise – et sa supply chain – est résiliente si elle peut résister à un choc non planifié et systémique qui menace le flux de marchandises, puis rétablir ce flux à son état antérieur.
Il y a deux qualificatifs importants dans cette phrase.
Le premier est “non planifié”. De nombreux événements désagréables ne constituent pas des chocs au sens ici évoqué. Une flambée de la demande en haute saison, une promotion qui fonctionne mieux que prévu, le fait que les délais soient bruyants plutôt que constants – rien de tout cela n’est nouveau ou mystérieux. Il peut être difficile de les modéliser avec précision, mais cela ne sort pas du domaine d’une anticipation raisonnable. Si vous êtes en rupture de stocks chaque Noël, ce n’est pas un problème de résilience ; c’est un problème de planification.
Le second qualificatif est “systémique”. Un seul magasin qui perd le courant, un camion qui tombe en panne, un fournisseur qui manque une livraison : ce sont des incidents locaux. Ils peuvent être frustrants voire coûteux, mais ils ne menacent pas la continuité du flux dans son ensemble. Un grand port fermé pendant des mois, un choc réglementaire qui rend soudainement une catégorie invendable, une guerre qui interrompt les routes commerciales à travers une région entière – ici, nous entrons dans le domaine systémique.
Pour moi, la résilience est réservée à ces événements rares, aux conséquences importantes, qui à la fois (a) n’auraient pas pu être planifiés en détail de manière raisonnable et (b) affectent une portion substantielle de la supply chain simultanément.
Tout le reste – le bruit quotidien de la demande, l’imprécision des délais, la chorégraphie habituelle des promotions, les pitreries prévisibles des concurrents – devrait être traité par une bonne pratique de la supply chain, et non présenté comme de la “résilience”.
La façon dont le courant dominant aborde la résilience
Si vous regardez la façon dont les grands fournisseurs de technologies, les associations professionnelles et les organisations politiques décrivent la résilience, vous verrez un tableau différent.
Une définition assez typique présente la résilience de la supply chain comme la capacité d’anticiper, de s’adapter et de se remettre des perturbations tout en maintenant le fonctionnement des opérations. L’accent est mis sur la continuité : le système doit continuer à offrir des taux de service acceptables même lorsqu’un événement inattendu survient.
Les principaux organismes professionnels ajoutent une nuance supplémentaire : la résilience est la capacité de revenir à un état d’équilibre après que la performance s’est écartée des attentes. Dans ce cadre, la résilience consiste à retrouver le “normal” après une perturbation, et elle peut être améliorée en disposant de plus d’options de réponse et en y réagissant rapidement.
À partir de là, une liste familière de leviers réapparaît sans cesse. La redondance sous forme de stocks supplémentaires, de capacité de secours et de fournisseurs alternatifs. La flexibilité grâce à une main-d’œuvre polyvalente et une production adaptable. La visibilité et la collaboration, souvent rendues possibles par des plateformes digitales, pour détecter les problèmes plus tôt et coordonner les réponses. Des rapports récents de politiques et de conseil ajoutent un autre niveau : la nécessité de “balancer” l’efficacité et la résilience, parfois en reconfigurant les réseaux, en ajustant les empreintes d’approvisionnement ou en investissant dans de nouvelles technologies. Des revues académiques, notamment du point de vue de la gestion des stocks, répertorient des stratégies telles que la constitution de stocks, le multi-sourcing, la réservation de capacité et des contrats flexibles sous l’intitulé de “stratégies de résilience”.
Il n’y a rien d’absurde dans cette vision dominante. Les leviers qu’elle énumère sont réels ; les compromis qu’elle met en avant le sont également. Mon inquiétude est que, pris ensemble, ce vocabulaire transforme la résilience en une étiquette amicale que l’on peut apposer sur presque n’importe quel projet d’amélioration : plus de stocks ? C’est de la résilience. Moins de stocks, mais dans de “meilleurs” endroits ? Toujours de la résilience. Un nouveau tableau de bord ? La résilience. Un nouveau processus ? Encore de la résilience.
Lorsqu’un mot commence à signifier “tout ce qui ressemble à une bonne idée”, il cesse rapidement d’être utile.
Pourquoi j’insiste sur une frontière plus nette
Je trace une ligne nette entre le domaine de la résilience et celui de l’excellence ordinaire de la supply chain, car ces deux domaines sont régis par des types de connaissances différents.
La plupart de ce à quoi une équipe de supply chain est confrontée est incertain, mais pas mystérieux. La demande varie, mais de manière qui peut être capturée – de façon imparfaite, mais utile – par des modèles statistiques. Les délais sont bruyants, mais leur variabilité peut être mesurée. Les promotions, les changements de prix, les variations d’assortiment, les événements calendaires : tous apportent une structure à cette incertitude. Nous pouvons attribuer des probabilités et des conséquences économiques à bon nombre de ces schémas.
Dans cet espace, la bonne question n’est pas “Comment devenir résilients ?” La bonne question est : “Au vu de ce que nous savons sur les distributions de la demande, des délais et des prix, quelle est la meilleure décision à prendre aujourd’hui en termes économiques ?” Une bonne décision, en ce sens, est un pari : elle pèse les résultats possibles et leur impact financier. Elle accepte que certains jours, nous perdions le pari, tout en rendant ces pertes faibles et supportables.
Si nous qualifions chaque échec dans ce domaine de “problème de résilience”, nous excusons beaucoup de fragilité évitable. Une règle de stock de sécurité qui ignore l’incertitude des délais ne devient pas respectable simplement parce que nous affirmons qu’elle fait partie d’une stratégie de résilience. Un processus de réapprovisionnement qui ne peut pas faire face aux promotions ne souffre pas d’une défaillance de résilience ; il est simplement mal conçu.
La résilience, telle que j’emploie le terme, ne commence qu’à l’endroit où une telle réflexion probabiliste et axée sur l’économie cesse d’être suffisante – là où nous sommes confrontés à des événements qui dépassent le répertoire des schémas que nos modèles, notre expérience et nos données peuvent raisonnablement couvrir.
Les décisions comme des paris, et pourquoi cela compte pour les chocs
Même lorsque nous ne sommes pas confrontés à des chocs, chaque décision de supply chain est un pari sur l’avenir. Nous n’en prenons guère conscience, car les décisions sont nombreuses et répétitives : un réapprovisionnement ici, une série de production là, un camion à acheminer, un prix à ajuster. Mais derrière chacune de ces actions se cache une vision implicite de ce qui pourrait se passer et du coût que représenterait chaque résultat.
Ce qui m’intéresse, c’est la forme de ce pari.
De nombreuses organisations, souvent inconsciemment, conçoivent leurs processus de sorte que les décisions soient extrêmement sensibles à une vision restreinte de l’avenir. Une prévision est traitée comme un chiffre unique. Les taux de service sont considérés comme des seuils sacrés. La capacité est exploitée à près de la saturation. Les quantités minimales de commande et les contraintes rigides impliquent de gros engagements dès le début. Tant que le monde se comporte à peu près comme prévu, cela paraît efficace : les stocks sont faibles, l’utilisation est élevée, les coûts paraissent raisonnables.
Au moment où la réalité dévie – et cela se produit toujours, même sans confinement ni guerre – ces décisions s’avèrent fragiles. Une surprise modeste dans la demande, un léger retard d’un fournisseur, ou un petit changement réglementaire se répercute à travers le réseau de manière imprévue, car les paris sous-jacents n’avaient aucune marge pour la déviation.
De mon point de vue, la résilience ne concerne pas principalement ce que vous faites après un choc. Il s’agit de la structure des paris que vous effectuez avant celui-ci. Une supply chain qui prend systématiquement des paris fragiles ne deviendra pas magiquement résiliente lorsqu’un événement sérieux surviendra. Inversement, une supply chain qui évalue correctement l’incertitude – qui accepte une certaine marge là où celle-ci est peu coûteuse et des pénuries dommageables lorsqu’elles sont abordables – se comportera souvent avec grâce, même sous pression.
C’est pourquoi je vois la résilience comme un effet secondaire d’une prise de décision disciplinée en situation d’incertitude, et non comme une couche distincte de processus et de tableaux de bord.
Capacité, automatisation, et le facteur humain
Il y a un autre aspect, plus humain, qui est souvent négligé : la capacité des personnes censées se soucier de la résilience.
Dans de nombreuses entreprises, les équipes de supply chain vivent dans un état d’incendie permanent. Elles réconcilient des données incohérentes provenant de multiples systèmes, annulent manuellement des plans qui n’ont aucun sens, passent d’une exception à l’autre, et assistent à d’innombrables réunions pour expliquer les problèmes d’hier. Les outils qui étaient censés simplifier leur vie génèrent en réalité la majeure partie du bruit qu’ils doivent filtrer.
Dans un tel environnement, qui a le temps – ou l’énergie mentale – de réfléchir sérieusement aux chocs peu fréquents mais à fort impact ? L’agenda est entièrement absorbé par des problèmes à la fois urgents et auto-infligés.
Ma position est que toute approche crédible de la résilience commence par libérer cette capacité. Cela signifie automatiser la grande majorité des décisions routinières, non pas avec des règles simplistes, mais avec des moteurs quantitatifs qui comprennent suffisamment l’incertitude et l’économie pour effectuer des milliers de petits paris au nom de l’organisation. Lorsque les machines se chargent de ce qu’elles font de mieux – des choix répétitifs, basés sur les données et sous des règles stables – les humains peuvent se concentrer sur ce pour quoi ils sont particulièrement adaptés : imaginer des modes de défaillance qui ne se sont pas encore produits, remettre en question les hypothèses et décider quels risques structurels l’entreprise est prête à assumer.
Sans ce changement, une grande partie des discussions sur la résilience ne reste que de la parlote.
Là où je diverge de la pratique dominante
Tout cela crée une divergence discrète mais significative entre ma vision de la résilience et celle qui domine la plupart des discussions de l’industrie.
La première divergence concerne la prévision et le risque. Dans la pratique courante, la prévision est généralement considérée comme une activité distincte, presque sacrée : un chiffre unique par référence et par période, parfois agrémenté de scénarios. La gestion des risques intervient ensuite avec des cartes de chaleur, des registres et des ateliers. D’après mon expérience, cette séparation est artificielle. L’incertitude n’est pas un supplément ; c’est la matière première de chaque décision. Lorsque nous la comprimons en prévisions ponctuelles et que nous entourons ensuite ces chiffres du concept de “risque”, nous nous préparons déjà à des résultats fragiles.
La deuxième divergence concerne les indicateurs. Une grande partie de la littérature sur la résilience est formulée en termes de temps de récupération, de taux de service minimum acceptable pendant une perturbation, d’indices d’exposition et d’autres indicateurs clés de performance similaires. Ces indicateurs peuvent être utiles pour la communication, mais si nous les optimisons directement, nous sommes tentés de traiter la résilience comme une vertu devant être augmentée de manière abstraite. Je préfère une question plus prosaïque : pour une catégorie donnée de choc, combien d’argent s’attendrait-on à perdre avec notre conception actuelle, et combien coûterait la réduction de cette perte d’un certain montant ? Une fois formulé ainsi, la résilience cesse d’être mystique. Elle devient une question d’allocation de capital.
La troisième divergence concerne la redondance. De nombreux guides pratiques sur la résilience encouragent des stocks supplémentaires, davantage de fournisseurs, plus de capacité et davantage de routes comme des éléments intrinsèquement positifs. Je ne partage pas cet enthousiasme. Une partie de la redondance est extrêmement précieuse; une autre relève du pur gaspillage. La différence réside dans la valeur optionnelle : qu’est-ce qu’un fournisseur supplémentaire, une capacité de réserve ou ce stock tampon nous permet de faire face à l’incertitude, ce que nous ne pourrions pas faire autrement, et à quelle fréquence cette option est-elle réellement susceptible d’être utilisée ? Ce n’est qu’en répondant à cette question en termes financiers que nous pouvons déterminer si un “investissement en résilience” donné a du sens.
Enfin, il y a la question de la gouvernance. Une grande partie de la pensée dominante place la résilience dans des comités, des cadres et des programmes de certification. Ceux-ci peuvent avoir leur place, mais les décisions clés qui déterminent la résilience sont souvent de nature entrepreneuriale : qu’il s’agisse de concentrer la production dans un seul site très efficace ou d’accepter les frais généraux liés à plusieurs usines dans différentes juridictions ; qu’il s’agisse de se reposer sur un petit nombre de fournisseurs hautement optimisés ou de maintenir des relations avec des alternatives qui pourraient être moins compétitives à court terme. Ce ne sont pas des choix techniques relevant de la fonction supply chain ; ce sont des décisions stratégiques concernant les types de chocs que l’entreprise est prête à supporter.
Résilience, robustesse et antifragilité
Il convient également de distinguer la résilience de deux concepts voisins : la robustesse et l’antifragilité.
Un système robuste est celui qui est à peine affecté par des perturbations dans une certaine plage. Il continue à fonctionner presque comme avant. Un système résilient subit un choc, mais se rétablit. Un système fragile est celui qui ne peut pas se rétablir : le choc le pousse au-delà d’un point de non-retour.
L’antifragilité, un terme popularisé par Nassim Nicholas Taleb, va un pas plus loin : il décrit des systèmes qui tirent réellement profit de la volatilité. Ils bénéficient du désordre au lieu de simplement y survivre.
Sur des marchés compétitifs, un comportement antifragile tend à l’emporter sur le long terme. Les entreprises qui ne considèrent les chocs que comme des menaces se feront dépasser par celles qui les perçoivent également comme des opportunités : acquérir des actifs en difficulté, gagner des parts de marché, renégocier les conditions, accélérer des changements qui prendraient autrement des années. La supply chain, à elle seule, ne peut pas rendre une entreprise antifragile, mais elle peut soit favoriser, soit entraver cette approche. Un réseau constamment au bord de l’effondrement ne peut pas faire preuve d’opportunisme lorsque survient une perturbation.
C’est une autre raison pour laquelle je résiste à traiter la résilience comme un domaine technique restreint. À un moment donné, la conversation doit aborder l’appétit pour le risque fondamental et l’imagination de l’entreprise.
Conséquences pratiques de cette vision
Qu’est-ce que tout cela signifie en pratique ?
Cela signifie que, avant de lancer de grands “resilience programs,” nous devrions d’abord remettre de l’ordre dans les fondamentaux de notre manière de prendre des décisions en situation d’incertitude. Comptons-nous encore sur des prévisions à chiffre unique et des formules statiques de safety-stock qui ignorent la variabilité des délais? Appliquons-nous des contraintes rigides – comme des quantités minimales de commande arbitraires ou des règles de chargement complet – qui éliminent les options au nom de la simplicité?
Cela signifie que nous devrions investir sérieusement dans l’automatisation des décisions digne de ce nom : des systèmes qui intègrent des visions probabilistes de la demande, des délais et des prix, et qui optimisent les résultats économiques plutôt que des cibles arbitraires de taux de service. Il ne s’agit pas d’acheter un tableau de bord. Il s’agit de construire ou d’adopter des moteurs capables de prendre en charge une grande partie de la charge combinatoire quotidienne, afin que les experts humains puissent se concentrer sur des questions structurelles.
Cela signifie que nous devrions identifier les quelques expositions véritablement systémiques qui comptent pour notre entreprise. Pour chacune d’elles, nous pouvons poser des questions simples, bien qu’inconfortables : si ce port, cette devise, cet environnement réglementaire ou cette région politique nous était inaccessible pendant un an, que se passerait-il réellement ? Survivrions-nous, et sous quelle forme ? Si la réponse honnête est « nous ne savons pas », alors la mesure est la priorité. Si la réponse est « nous serions finis », alors nous devons décider si ce risque est acceptable. S’il ne l’est pas, le remède ne sera guère un gadget ; il s’agira d’un changement structurel.
Cela signifie également accepter que la résilience a un prix. Une supply chain véritablement plus résiliente paraîtra souvent moins « efficace » selon les indicateurs très étroits que nous avons appris à vénérer : elle peut comporter davantage de marge de manœuvre, partager une plus grande marge avec ses partenaires, ou maintenir des capacités qui paraissent inactives la majeure partie du temps. La question n’est pas de savoir si ce prix existe, mais s’il vaut la peine d’être payé compte tenu des chocs qui nous importent véritablement.
La résilience, telle que je la conçois, n’est pas une nouvelle couche de complexité à ajouter à une discipline déjà surchargée. C’est la conséquence à long terme de prendre l’incertitude et l’économie au sérieux dans les petites décisions que nous prenons quotidiennement, et d’avoir le courage d’effectuer quelques grands choix structurels en pleine conscience des chocs que nous ne pouvons exclure.
Si nous réservons le mot « résilience » pour ces chocs, et si nous considérons tout le reste comme du travail ordinaire de supply chain qui peut et doit être automatisé et amélioré sans drame, alors le terme retrouve sa précision. Il devient quelque chose dont nous pouvons raisonner, investir et – en cas de besoin – échanger délibérément contre d’autres objectifs.
C’est, du moins, le type de résilience qui m’intéresse.