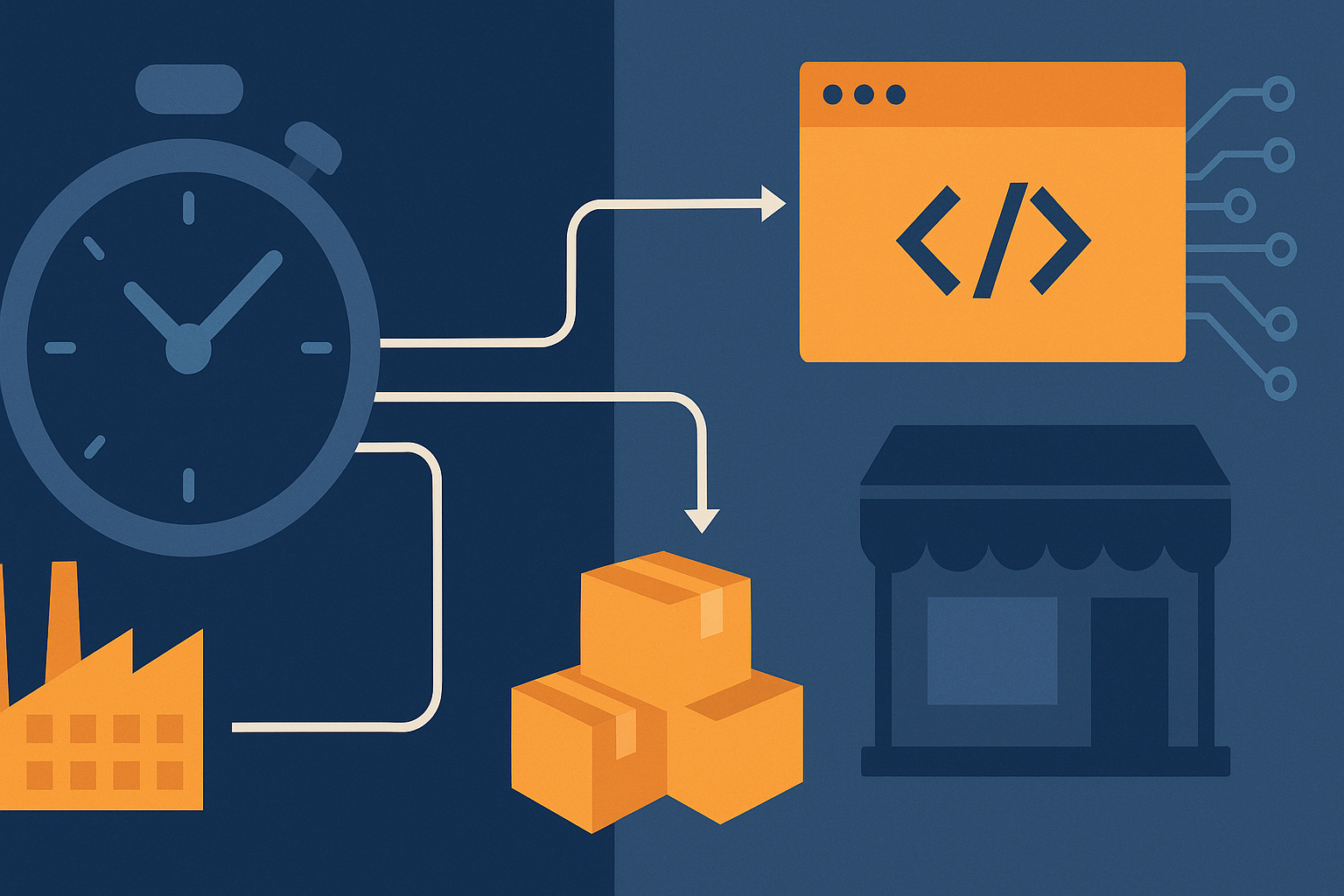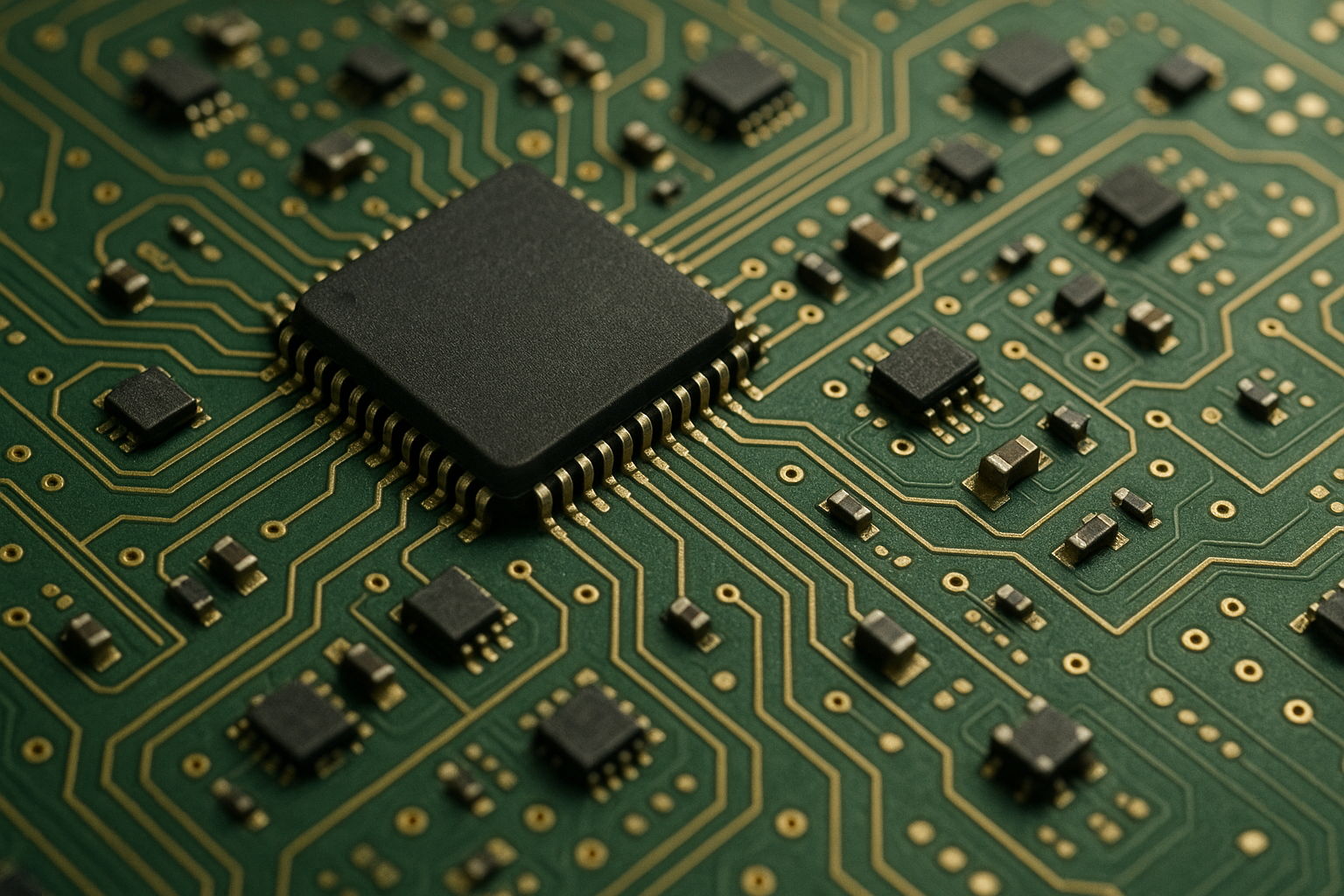Repenser la division du travail à l'ère des supply chains automatisées
La division du travail est l’une de ces idées tellement ancrées dans la vie moderne que nous finissons par ne plus la remarquer. Adam Smith ouvre La Richesse des Nations avec l’usine d’épingles désormais célèbre, où diviser un métier en de nombreuses petites tâches multiplie la productivité par des ordres de grandeur.

Je partage cette admiration. Sans spécialisation et commerce, il n’existerait tout simplement pas de « moderne » à évoquer. Pourtant, après près de deux décennies passées à travailler dans de vraies supply chains, j’en suis également arrivé à croire que nous appliquons l’idée de division du travail de manières qui jouent contre nous – en particulier au sein des entreprises et encore plus dans les logiciels que nous utilisons pour les gérer.
Dans mon livre Introduction to Supply Chain, je soutiens que la supply chain, en tant que discipline, consiste à prendre de meilleures décisions sur les flux de marchandises en situation d’incertitude, au service de la rentabilité à long terme. Dans cet essai, je souhaite isoler un fil conducteur de cet argument plus large : comment la division du travail nous aide à l’échelle globale, tout en nous nuisant souvent à l’échelle organisationnelle, et comment l’automatisation modifie ce tableau.
L’histoire classique : des épingles aux chaînes de valeur mondiales
L’histoire classique est bien connue. La division du travail, que ce soit au sein d’une usine ou entre différents pays, explique une grande partie des gains de productivité ayant relevé le niveau de vie au cours des deux derniers siècles. Les fabricants d’épingles de Smith sont les ancêtres d’un semblant de chaînes de valeur mondiales, où différents pays se spécialisent dans des étapes distinctes de la vie d’un produit : la conception dans un lieu, la fabrication de composants dans un autre, l’assemblage ailleurs, et la distribution sur un continent différent.
La gestion de la supply chain moderne a hérité de ce récit. Il suffit de regarder un cadre largement cité tel que la définition de la gestion de la supply chain par Douglas Lambert comme “la gestion des relations dans le réseau d’organisations… à l’aide de processus d’affaires transversaux clés pour créer de la valeur.” L’accent est mis résolument sur la coordination entre des fonctions spécialisées et entre les entreprises : marketing, logistique, production, achats, finance, R&D, etc.
Dans cette vision grand public, le rôle de la gestion de la supply chain est de s’assurer que cette division du travail étendue fonctionne sans accroc. Les silos fonctionnels sont reconnus comme un problème, mais on recommande presque toujours une collaboration plus structurée : des équipes de processus transversaux, des cycles de planification intégrés et, en particulier, le Sales & Operations Planning (S&OP). Le S&OP est généralement décrit comme un moteur de réunions récurrentes et transversales qui aligne ventes, marketing, supply chain et finance sur un plan unique.
Jusqu’à présent, rien à redire. La division du travail, la coordination et une couche technologique de soutien : voilà, en gros, comment nous en sommes arrivés là.
Mais si nous prêtons attention à ce qui se passe réellement à l’intérieur des entreprises, en particulier les grandes, un paradoxe apparaît.
Le coût caché de la division du travail interne
La division du travail est avant tout une manière de pallier les limites humaines. Aucune personne ne peut suivre chaque produit, fournisseur et client ; c’est pourquoi nous répartissons le travail. Un planificateur s’occupe d’une région, un autre d’une gamme de produits, et encore un autre de l’assortiment de niche. Un département est chargé des achats, un autre de la tarification, et un autre des promotions.
Dans une conférence intitulée On Knowledge, Time and Work for Supply Chains, j’ai distingué deux grandes manières de répartir le travail. L’une répartit des activités similaires entre plusieurs personnes (la division du travail « horizontale »), l’autre superpose différents niveaux de responsabilité dans une hiérarchie (la division « verticale »). Les entreprises modernes s’appuient fortement sur les deux.
Cela fonctionne – jusqu’à un certain point. Cela engendre également une série d’effets secondaires si courants que nous les prenons pour des lois de la nature.
Premièrement, la complexité se traduit directement par une augmentation des effectifs. Chaque fois qu’une entreprise ajoute des SKU, des canaux, des régions ou des contraintes, elle répond très souvent en ajoutant des planificateurs. Le modèle mental dominant est à peu près linéaire : deux fois plus de pièces mobiles, deux fois plus de personnes. Il n’est pas rare de voir des équipes dont le travail quotidien consiste à parcourir des listes interminables dans des tableurs ou des outils de planification, en effectuant de minuscules ajustements manuels dont personne ne se souviendra la semaine suivante.
Deuxièmement, les leviers clés sont fragmentés entre les fonctions. La tarification et les promotions relèvent du marketing, les décisions d’assortiment du merchandising, les engagements de service des ventes, tandis que les stocks et la capacité sont laissés à la “supply chain”. Pourtant, toutes ces décisions déterminent ce qui se déplace où et quand, influençant ainsi le résultat économique des flux. Cette répartition ne repose pas sur l’économie, mais sur l’histoire de l’entreprise.
Troisièmement, les systèmes d’entreprise pérennisent la division du travail d’hier. La majeure partie de la logique des ERP, des outils APS et des systèmes similaires ne concerne pas l’économie ou les statistiques ; elle détermine qui est autorisé à faire quoi, dans quel ordre, avec quels codes de statut, escalades et validations. Comme je l’ai récemment noté en évoquant la gestion du cycle de vie des produits, la quasi-totalité de la logique métier existe pour orchestrer les flux de travail humains et leurs transferts. Lorsqu’on automatise correctement les décisions, une part surprenante de cet échafaudage devient redondante.
Quatrièmement, la responsabilité se dilue. Lorsque chaque étape d’un processus est confiée à un groupe différent, il devient douloureusement facile pour chacun d’être « impliqué » sans qu’aucune personne ne soit tenue responsable de la qualité de la décision finale. J’ai vu de nombreuses initiatives “quantitative” échouer, non pas parce que les mathématiques étaient défaillantes, mais parce que le travail était morcelé en tellement de morceaux — extraction des données par l’IT, nettoyage des données par une équipe, prévisions par une autre, réglage des paramètres par les planificateurs — qu’aucune personne ou équipe unique ne pouvait revendiquer véritablement le résultat.
C’est toujours de la division du travail. Cela apporte des efficacités locales, mais cela ne nous aide pas nécessairement à prendre de meilleures décisions, ce qui est, au final, ce qui compte.
L’automatisation impose une division plus fondamentale
Depuis environ quarante ans, on évoque l’automatisation des décisions en supply chain : d’abord le contrôle des stocks, ensuite la planification des besoins en distribution, et ainsi de suite. En pratique, la plupart des entreprises s’appuient toujours sur les personnes comme mécanisme de décision principal. Les ordinateurs fournissent des chiffres, des tableaux de bord et des alertes ; les humains restent impliqués au niveau le plus granulaire.
De mon point de vue, c’est le mauvais point de départ.
La première et la plus importante division du travail que nous devrions établir n’est pas entre les départements, mais entre humains et machines.
Les machines excellent de manière extraordinaire dans certaines tâches qui dominent les supply chains modernes : traiter d’énormes quantités de données transactionnelles ; recalculer les décisions quotidiennement, voire à l’heure ; et respecter une politique sans fatigue ni sautes d’humeur. Les humains, en revanche, sont relativement moins performants dans la répétition à grande échelle, mais très doués pour remettre en question les hypothèses, interpréter le contexte et inventer de nouvelles manières d’encoder l’économie dans des règles.
Une fois cela accepté, la question de la conception change. Plutôt que de se demander “Comment devrions-nous répartir les SKU et les fournisseurs entre nos planificateurs ?”, nous devrions nous interroger : “Quelles catégories de décisions devraient être entièrement automatisées, et comment concevoir le système qui les réalisera ?”
Dans mes conférences sur la Supply Chain Quantitative, je décris le livrable comme un moteur de décision : un système analytique qui transforme des données brutes en décisions concrètes telles que des bons de commande, des transferts de stock ou des changements de prix, sans intervention manuelle dans l’exécution quotidienne. La conception du moteur est un travail intensément humain ; son exécution de routine ne l’est pas.
Ce n’est pas de la science-fiction. Lorsque nous exigeons que le résultat du système analytique soit de réelles décisions, et non de simples prévisions ou scores, et lorsque nous imposons que son fonctionnement soit entièrement automatisé, nous découvrons qu’une grande partie de la charge de travail répétitive de planification peut effectivement être mécanisée. Le résultat est une forme différente de division du travail : un petit nombre de personnes travaillant sur la logique qui régit des milliers, voire des millions, de micro-décisions.
Redéfinir les rôles autour du moteur de décision
Si nous prenons cette division axée sur l’automatisation au sérieux, la division du travail interne commence à prendre une tout autre apparence.
Les personnes qui passaient leurs journées à ajuster des commandes dans des tableurs endossent désormais des rôles plus stratégiques et investigateurs. Au lieu de se demander à répétition “Que devrais-je commander pour ce SKU aujourd’hui ?”, elles se demandent “Pourquoi le moteur de décision a-t-il recommandé ce schéma pour cette famille de produits ?” et “Que nous révèle cela sur nos coûts, contraintes et options ?” En effet, elles deviennent les gestionnaires des flux, responsables de la compréhension et de l’affinement de la logique économique, et non de la saisie de chiffres.
Par ailleurs, un profil spécialisé émerge à l’intersection de la supply chain, des statistiques et du génie logiciel. Cette personne, que l’on appelle parfois un Supply Chain Scientist, est responsable du comportement du moteur de décision lui-même : la manière dont l’incertitude de la demande est modélisée, la façon dont les pénuries et les excédents de stocks sont évalués économiquement, la manière dont les contraintes logistiques sont exprimées, et la façon dont tout cela est traduit en code exécutable.
Il est crucial de noter que ce scientifique ne « appartient » pas à l’IT, même s’il travaille avec du code et des données. L’IT conserve la responsabilité de la fiabilité et de la sécurité des pipelines de données – pour s’assurer que les systèmes transactionnels sont correctement répliqués dans le stockage analytique – mais la responsabilité de formuler les décisions repose fermement sur la fonction supply chain. Cette division explicite entre l’infrastructure et la logique décisionnelle constitue, en elle-même, une nouvelle division du travail, qui préserve la clarté de l’attribution des responsabilités plutôt que de la diluer.
La finance redevient également un acteur de manière plus constructive. Plutôt que de débattre de savoir si une prévision donnée est « réaliste » lors d’une réunion S&OP, la finance et la supply chain collaborent pour exprimer les préférences économiques réelles de l’entreprise – coût du capital, pénalité en cas de rupture de stock, engagements de service envers les clients clés – sous une forme que le moteur de décision peut comprendre. Une fois ces préférences encodées, elles s’appliquent systématiquement à des milliers de décisions, chaque jour, sans nécessiter une réunion à chaque fois.
Le résultat final demeure la spécialisation. Les personnes ne deviennent pas des généralistes interchangeables. Mais le principe organisateur n’est plus l’organigramme ou la séquence de traitement des transactions ; il s’agit de la conception, de l’exploitation et de l’amélioration continue d’un système de décision.
En quoi cela diffère de l’« intégration » grand public
À ce stade, il est naturel de se demander : n’est-ce pas simplement une autre manière de parler de l’intégration ? Après tout, la gestion de la supply chain grand public a passé les vingt dernières années à souligner la nécessité de briser les silos grâce à des processus transversaux et des indicateurs partagés.
Il y a une différence importante.
Dans la vision grand public, l’intégration signifie faire intervenir davantage de personnes issues de plusieurs fonctions dans la conversation. Le diagramme type du S&OP présente ventes, marketing, opérations, supply chain et finance autour de la table, soutenus par des logiciels de planification de plus en plus sophistiqués. La collaboration est la ressource rare ; la technologie est là pour la faciliter : données partagées, tableaux de bord partagés, workflows partagés.
Pour moi, l’intégration signifie quelque chose de complètement différent. Cela signifie que la logique économique est unifiée. La hiérarchie des priorités – service contre marge contre capital employé – est exprimée une seule fois, à l’intérieur du moteur de décision, puis appliquée partout. La ressource rare principale n’est pas le temps de réunion, mais la clarté : la clarté sur ce que l’entreprise cherche à optimiser et sur la manière dont cette intention se traduit en décisions opérationnelles.
Lorsque nous partons de cet angle, nous découvrons généralement que de nombreux mécanismes de coordination mis en place au fil des ans compensaient l’absence d’automatisation. Nous avions besoin de longues réunions parce que chaque décision était, en pratique, sur mesure. Nous avions besoin de flux de travail élaborés et de chaînes d’approbation parce qu’il n’existait pas de politique unique, fiable et exécutable.
C’est pourquoi je suis sceptique quant aux efforts visant à « moderniser » le S&OP traditionnel en y ajoutant une couche d’analytique avancée tout en conservant sa structure de base intacte. Que ce soit lors des débats que nous organisons chez Lokad ou dans la littérature académique, le S&OP est encore largement présenté comme un processus de négociation interfonctionnelle, avec la technologie pour facilitateur. Je crois que pour de nombreuses entreprises, la véritable transformation ne découlera pas de meilleures réunions, mais du fait d’en avoir besoin de beaucoup moins dès le départ.
La division du travail au niveau mondial : accord, avec une mise en garde
Toute cette argumentation pourrait laisser penser que je suis opposé à la division du travail dans son ensemble. Ce n’est pas le cas. Au niveau mondial, je considère que la spécialisation poussée et le commerce sont non négociables si nous tenons à la prospérité. La division internationale du travail élaborée qui caractérise les chaînes de valeur modernes n’est pas une curiosité fragile ; c’est la seule raison pour laquelle nous pouvons nous offrir les biens et services dont nous jouissons actuellement.
Cependant, cette spécialisation mondiale s’accompagne d’une fragilité systémique, comme les récentes vagues de perturbations nous l’ont douloureusement rappelé. Lorsqu’un confinement ferme des usines, ou qu’un canal se bloque, ou qu’un conflit interrompt les exportations, le choc se propage à travers les mêmes réseaux qui nous apportent habituellement de l’efficacité. La réponse n’est pas de sombrer dans l’autarcie. Il s’agit de devenir beaucoup plus précis dans la gestion des risques : cultiver l’optionnalité chez les fournisseurs et sur les routes, en mesurer le coût, et utiliser l’automatisation pour réagir rapidement lorsque la réalité s’écarte des prévisions.
En ce sens, mon désaccord avec le courant dominant ne porte pas sur le fait que la division du travail soit souhaitable, mais sur l’endroit où nous l’acceptons comme acquise et où nous devrions être prêts à la redéfinir.
Une autre manière d’organiser le travail
Si nous mettons toutes les pièces ensemble, une vision différente de l’organisation de la supply chain émerge.
Au niveau mondial, nous adoptons la division du travail qui sous-tend le commerce et la productivité, tout en étant conscients de sa fragilité et en œuvrant délibérément à créer des options. Au sein de l’entreprise, nous résistons au réflexe de répondre à chaque augmentation de complexité par une augmentation proportionnelle du nombre de planificateurs et de couches de processus. Au lieu de cela, nous investissons dans des moteurs de décision capables de supporter le fardeau répétitif, et nous redéfinissons notre division du travail interne autour de la conception, de la gouvernance et de l’amélioration continue de ces moteurs.
Ce n’est pas moins humain. C’est plus. Il traite les planificateurs comme des stratèges potentiels, des enquêteurs et des concepteurs de meilleures règles économiques, plutôt que comme un intermédiaire humain entre les feuilles de calcul et les ERP. Il traite les services IT comme un partenaire critique dans la fourniture d’une infrastructure de données solide, sans confondre cela avec la propriété de la logique métier. Il considère la finance comme une co-auteure du modèle économique, et non simplement comme l’approbateur final des budgets.
L’histoire classique de la division du travail, de l’usine d’épingles de Smith jusqu’aux chaînes de valeur mondiales d’aujourd’hui, reste valable. Mais si nous nous arrêtons là, nous passons à côté de la leçon qui importe le plus pour les supply chains contemporaines : à une époque où les machines peuvent reprendre une grande partie de la réflexion répétitive, la décision véritablement stratégique est de déterminer comment répartir le travail entre les humains et les machines, et seulement ensuite comment le partager entre nous.