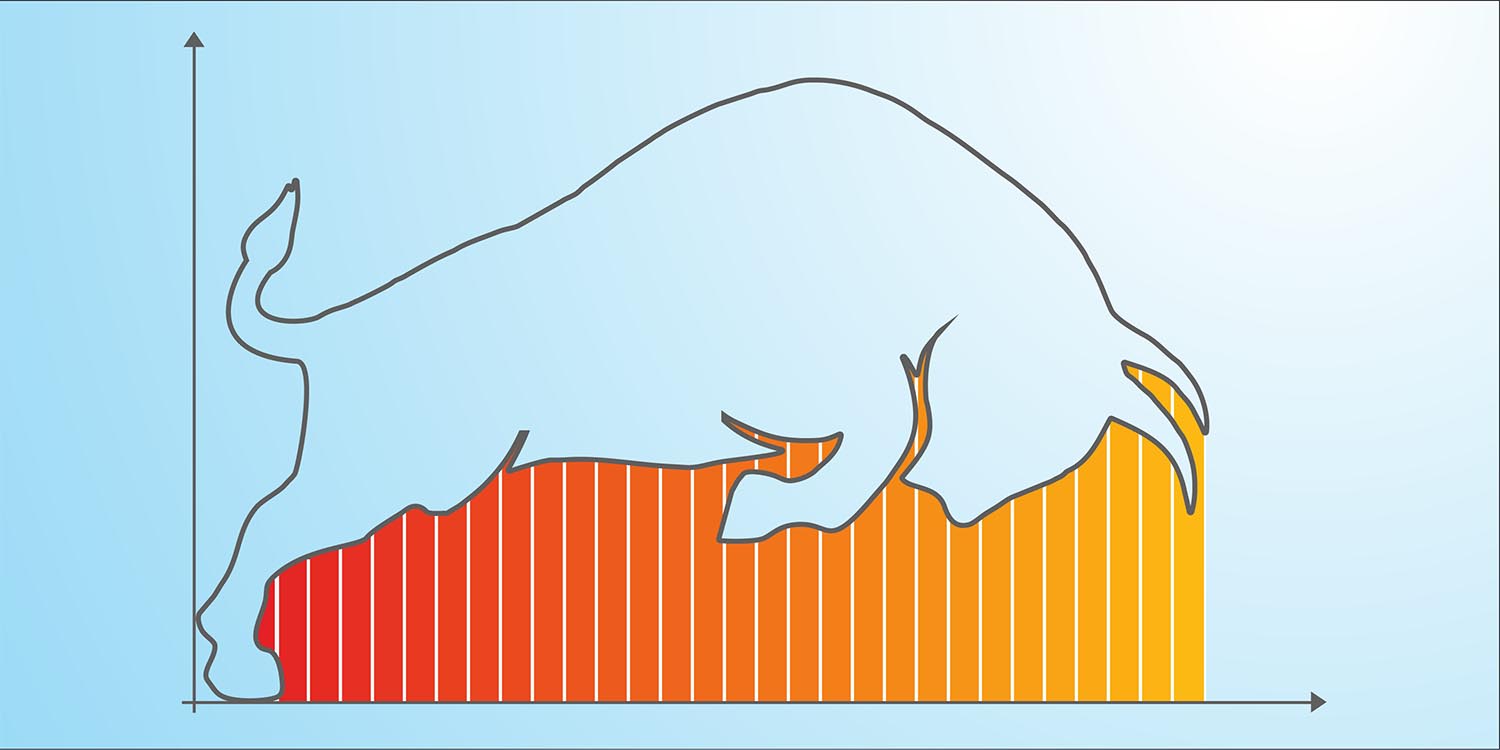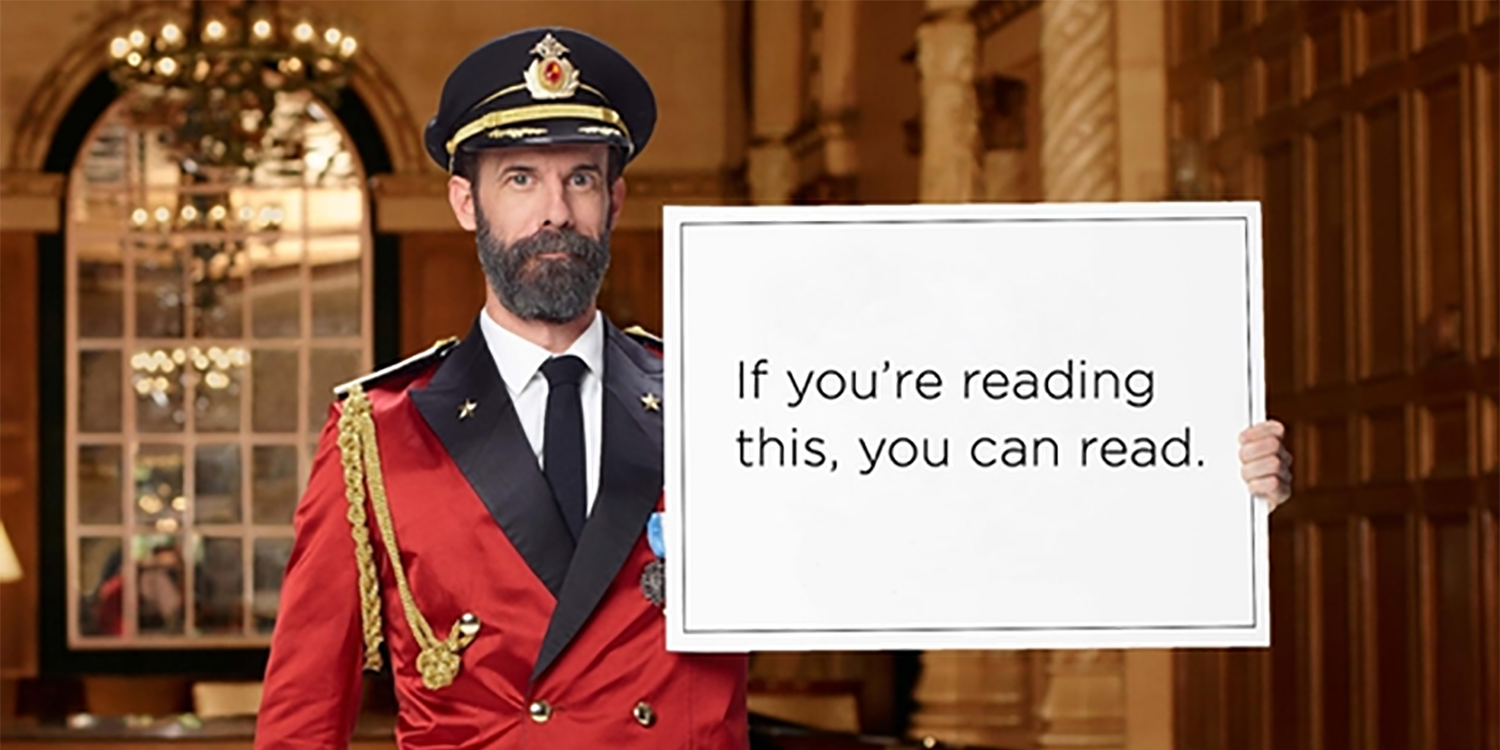Anecdotes de terminologie supply chain
L’émergence d’une terminologie est, au mieux, un processus hasardeux. La supply chain n’est pas une exception et, avec le recul, une grande partie de la terminologie de la supply chain est inadéquate. Une terminologie confuse nuit autant aux nouveaux arrivants qu’aux praticiens expérimentés. Les nouveaux arrivants peinent plus qu’ils ne le devraient face à une complexité accidentelle. Les praticiens ne se rendent peut-être pas compte que le fondement de leur domaine est plus fragile qu’il n’y paraît.

Examinons les contrevenants majeurs, du point de vue de la terminologie, dans la supply chain et proposons des alternatives appropriées. Même si ces alternatives sont peu susceptibles d’être adoptées par la communauté, elles devraient éclairer certaines nuances négligées. En règle générale, une bonne terminologie se veut aussi neutre et factuelle que possible. L’inclusion de qualificatifs positifs ou « cool » est un signal d’alerte.
Analyse ABC des stocks aurait dû être nommé segmentation par moyenne mobile. D’un point de vue terminologique, le terme « ABC » n’apporte rien, alors que « analysis » est d’une grande imprécision. L’expression « segmentation par moyenne mobile » est plus spécifique. Elle met en lumière les défauts inhérents à cette méthode. En effet, les moyennes mobiles non seulement créent de l’instabilité au fil du temps, mais ne parviennent pas non plus à refléter des schémas essentiels, tels que les cyclicités. De plus, la segmentation est un mécanisme crude qui, par conception, ne peut fournir de réponse granulaire au niveau SKU.
APS (Advanced planning and scheduling) aurait dû être nommé planning management. Premièrement, il n’y a rien d’avancé dans ces produits logiciels. Ce terme a été inventé dans les années 1990 par des analystes de marché pour promouvoir une série de vendeurs de logiciels. La plupart des produits logiciels relevant du domaine APS ne peuvent plus être considérés comme « avancés » selon les normes des années 2020. Deuxièmement, le planning management met l’accent sur des processus caractérisés par de nombreuses saisies manuelles de données. Les capacités statistiques ne représentent qu’une infime portion des logiciels. La majeure partie des fonctionnalités logicielles est destinée à l’utilisateur final, c’est-à-dire au supply and demand planner, qui gère manuellement le plan.
BI (Business Intelligence) aurait dû être nommé cube reporting. Premièrement, cette technologie n’a rien à voir ni avec l’intelligence, telle que dans « artificial intelligence », ni avec celle des services secrets. Ainsi, le terme « intelligence » n’a pas sa place ici. Deuxièmement, rien n’est intrinsèquement « business » dans cette technologie. Par exemple, afficher les températures quotidiennes passées par code postal constitue un cas d’utilisation parfait pour un cube reporting. Le cube reporting est une interface utilisateur superposée à une base de données cube, également connue sous le nom d’OLAP (online analytical processing) dans le jargon des bases de données. Le cube permet des opérations de slice and dice. Bien que le terme « cube » soit employé, le nombre de dimensions n’a pas à être égal à 3. Néanmoins, en pratique, ce nombre reste à un chiffre en raison de l’explosion combinatoire associée aux dimensions supérieures.
ERP (Enterprise Resource Planning) aurait dû être nommé ERM signifiant Enterprise Resource Management. Leur objectif principal, comme le suggère le nom ERM, est de suivre les actifs de l’entreprise. Ces produits ont peu ou rien à voir avec la planification. La conception fondamentale de l’ERM, qui repose en grande partie sur une base de données relationnelle, est en contradiction avec toute capacité prédictive. La terminologie « ERP » a été promue dans les années 1990 par des analystes de marché pour mettre en avant une série de software vendors qui essayaient de se différencier de leurs concurrents. Cependant, la partie « planning » des revendications n’a jamais eu beaucoup de consistance. Du point de vue logiciel, le domaine transactionnel est désormais bien distinct du domaine prédictif.
MRP (Material Requirements Planning) aurait dû être nommé MRM (Manufacturing Requirement Management). Les raisons sont essentiellement similaires à celles évoquées dans la discussion ERP vs. ERM. Il y a peu ou pas de planning impliqué et, lorsqu’il y en a, la conception penche fortement vers un processus manuel. De plus, le terme requirements est également dépassé, puisqu’il se réfère principalement à la gestion du BOM (bill of materials) qui ne représente de nos jours qu’une petite portion de ce que comporte la gestion moderne de la fabrication. Il y a donc peu de raison de mettre particulièrement l’accent sur ce terme.
Eaches (EA), une unité de mesure, devrait être mieux nommé obvious units (OU). Les eaches sont utilisés lorsque l’unité de mesure pertinente, lors du suivi des stocks, est censée être évidente, comme c’est généralement le cas pour les produits emballés. Malheureusement, l’intention d’origine se perd dans le terme « eaches ». De plus, « eaches » est grammaticalement étrange. La forme singulière, c’est-à-dire « 1 each », est déroutante et donc évitée en pratique.
EDI (Electronic Data Interchange) trouve son origine dans les années 1970 et désigne avant tout les logiciels qui transmettent des bons de commande aux fournisseurs, éliminant ainsi les interventions administratives dans le processus de commande. Malheureusement, avec l’avènement d’internet, même la simple navigation web qualifie techniquement comme un processus EDI. La notion de integrated suppliers (et inversement integrated clients), suggérant une intégration des systèmes informatiques respectifs, serait une meilleure manière de présenter la situation.
EOQ aurait dû être nommé flat bulk order. En effet, derrière ce terme, qui semble traduire une intention large, se cache une formule simpliste qui suppose que la future demand est constante (pas de saisonnalité), que le future lead time est constant (pas de variabilité), que le coût de commande est fixe (pas de remise sur quantité), et enfin, que le carrying cost est constant (pas de péremption). L’expression flat bulk order traduit bien la nature simpliste de la formule.
“Order” est un bon mot, mais employé seul, il reste profondément ambigu. Il existe des commandes client, des commandes fournisseur, des commandes de production, des commandes de mouvement de stocks, des commandes de rebut, etc. Un préfixe qualificatif est nécessaire pour donner du sens à l’expression. Le terme « level » est assez similaire à cet égard et ne doit pas être utilisé sans un préfixe qualificatif.
Safety stock aurait dû être nommé Gaussian buffer. En effet, il n’y a nothing safe rien de sûr dans cette méthode. Elle repose sur le fait que la future demand et le future lead time soient répartis selon des distributions normales (Gaussiennes), ce qui n’est jamais le cas, car les distributions d’intérêt ne suivent pas une loi normale dans le domaine de la supply chain. Le terme buffer clarifie l’intention associée aux stocks sans impliquer une vertu spécifique à cet agencement.
Saisonnalité est un bon terme, mais en général, le terme cyclicities serait plus approprié d’un point de vue supply chain. En effet, il a peu de sens de restreindre l’analyse des schémas de demande à la cyclicité annuelle, c’est-à-dire à la saisonnalité. Le jour de la semaine et le jour du mois représentent d’autres cyclicités évidentes qui doivent invariablement être prises en compte. Ainsi, un directeur supply chain recherche rarement une analyse de saisonnalité, mais plutôt une analyse de cyclicités.
Service level aurait dû être nommé service rate, ce qui serait plus cohérent avec le fill rate. Le terme level évoque une quantité, comme dans stock level. Cependant, le service level se mesure en pourcentage. C’est probablement l’un des contrevenants les moins flagrants de cette liste. Néanmoins, il serait préférable de pouvoir exprimer de manière plus directe la dualité entre service rate et fill rate.
Même les nouveaux arrivants (relativement) dans la supply chain bénéficieraient d’une meilleure terminologie.
DDMRP (demand driven material requirements planning) aurait dû être nommé sparse prioritized buffering. En effet, cette méthodologie n’apporte rien de spécifique pour isoler la « vraie » demande par opposition au flux : la censure, la cannibalisation ou les substitutions n’existent même pas numériquement dans ce cadre. De même, la plupart des angles de planification sont absents du cadre numérique : range planning, phase-in, phase-out, promotions, etc. Le mot-clé « sparse » qualifie justement l’intention associée à l’introduction des « decoupling points ».
Les decoupling points auraient dû être nommés managed SKUs. DDMRP propose un schéma de coloriage de graphes qui divise les SKUs en deux groupes : les decoupling points et le reste. Se référer à ces « points » en tant que SKUs est plus clair. De plus, comme ces SKUs sont les seuls destinés à être inspectés par le demand and supply planner, l’expression « managed SKUs » convient parfaitement et clarifie que tous les autres SKUs sont « unmanaged » du point de vue du planificateur.
Dans certaines situations, des simplifications spectaculaires peuvent être réalisées.
Artificial intelligence, autonomous system, blockchain, cognitive system, demand sensing, demand shaping, digital brain, knowledge graph, optimal algorithms peuvent tous essentiellement être remplacés par le mot magic. Bien qu’il existe divers degrés d’ingénierie réelle en dehors des cercles de la supply chain pour certains de ces mots à la mode, dans le contexte des logiciels d’entreprise supply chain, il s’agit de vaporware au sens le plus pur.
Enfin, certains termes restent adéquats même s’ils subissent parfois des critiques.
Value Chain est parfois proposé comme remplacement de Supply Chain. Un tel remplacement reflète une méconnaissance de la loi de Say, nommée d’après les travaux de Jean Baptiste Say, économiste de la fin du 19e siècle. Cette loi peut se résumer par l’offre est la source de la demande. L’offre vient en premier, la demande ensuite, et la valeur en dernier lorsque les transactions se réalisent enfin. La chaîne lie l’ensemble de l’affaire. La value chain est principalement vantée par des consultants cherchant à vendre un ROI à leurs prospects. Cependant, le terme « value » s’avère à la fois moins spécifique et plus biaisé positivement que son homologue « supply ».